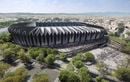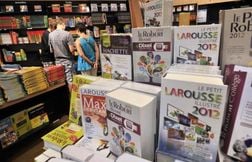
Paris : Pourquoi les boulangeries, épiceries ou librairies… se revendiquent « urbaines » ?
TENDANCE•Sur de nombreuses devantures de commerces à Paris, le terme « urbain » s’impose. Mais ça veut dire quoi ?Lina Fourneau
L'essentiel
- Dans les rues de Paris, il n’est pas rare de croiser de nombreux commerces affichant leurs appartenances à l’urbain.
- Pour la plupart des commerçants, cela reflète un rapport à la proximité et au local différent.
- Mais selon des linguistes, il est important de voir ici une réappropriation des villes.
Au cœur du 11e arrondissement, une nouvelle façade est apparue. Elle frappe par sa nouvelle devanture orange et jaune, dans les tons pastel qui correspondent aux tendances du moment. « Frappe », c’est justement le nom de cette boulangerie qui vient d’être rénovée, au coin des rues Sedaine et Saint-Sabin. Plus marquant encore, sur le commerce, on peut lire cette inscription « boulangerie urbaine ».

L’urbain s’impose désormais comme une mode à ne pas manquer dans les rues de Paris. Les épiceries, les fleuristes, les cafés et restaurants et maintenant les boulangeries s’en emparent. « Les enseignes sont des lieux où les gens aiment afficher les mots à la mode. Un commerce est moderne quand l’enseigne est moderne », note la linguiste Brigitte Rasoloniaina, maître de conférences à l’Institut national des langues et des civilisations orientales (Inalco).
Urbain et fière de l’être
Mais que faut-il comprendre derrière ce terme aussi large que tendance ? Pour les fondateurs de Frappe, ce terme correspond à « ce qui appartient à la ville, aux gens du quartier ». L’objectif ? Rendre le commerce de proximité plus agréable, « comme si c’était un peu chez eux ». « Il est clair que c’est un nom de marque », tranche d’emblée la linguiste Sandrine Reboul-Touré, maître de conférences à la Sorbonne-Nouvelle.
Mais si ce nom reflète un aspect commercial, le terme utilisé apporte du sens selon la spécialiste des langues. « C’est un adjectif relationnel, il est contraint à l’endroit où il se trouve, dans la ville. Mais ici, l’urbain a toujours une connotation très positive, qui s’oppose au rural. Pour Sandrine Reboul-Touré, les commerçants se disent « si tout le monde fait l’éloge de la ruralité, nous ferons l’éloge de tout ce qui est urbain pour montrer les côtés positifs de la ville, en enlevant les côtés négatifs, comme la surdensité ou la pollution » ». Par son utilisation, les nouveaux acteurs du commerce vont donc se réapproprier la ville, en revendiquant leurs appartenances.
Sa connotation positive, on la retrouve auprès de l’épicerie urbaine Sous les fraises, connue pour implanter de l’agriculture urbaine – on y revient – sur les toits de Paris. Pour son créateur, Yohann Hubert, l’intérêt de l’urbain vient d’abord de la proximité avec le lieu dans lequel on se trouve. « Notre objectif était de rendre un cadre de vie plus beau, en créant un lieu de rencontre et de partage avec les citadins, tout en rendant service au climat », explique le directeur général de Sous les fraises. Alors quand on lui parle de cette mode pour l’urbain, Yohann Hubert acquiesce : « C’est sûr qu’il y a un regain, une effervescence. Nous essayons tous de relocaliser nos responsabilités, sans doute. »
Un mot aux 1.000 visages
Plus loin, dans les hauteurs de Belleville, on retrouve un autre commerce qui a lui aussi misé sur l’urbain. Mais quand Xavier Capodano a ouvert la librairie Le genre urbain en 2002, il était loin de penser qu’il rentrait dans une logique marketing, qui deviendrait tendance 20 ans plus tard. En réalité, le nom lui vient un jour en sifflotant sur son vélo L’internationale, « j’ai une passion pour cette musique », avoue-t-il. « Il y a un passage qui mentionne "l’avenir du genre humain". Et moi je me suis dit : "Bah non, l’avenir c’est le genre urbain, pas le genre humain" ». Car ça tombe bien, Xavier Capodano est passionné par les questions urbaines. Depuis ses débuts, il organise trois fois par mois « des causeries » sur ces grands thèmes liés à la ville et réserve un petit rayon à la littérature spécialisée sur la question.
Alors, forcément, cette nouvelle tendance de l’urbain, ça le fait un peu grincer des dents. « La réalité du commerce a changé, la réalité de la vie et nos rapports aux gens aussi. On a vidé le sens des mots », regrette le libraire, qui le compare au terme « résilient », désormais utilisé à tout bout de champ dans les villes. Toutefois, le fondateur du Genre urbain l’avoue : « J’ai des techniques de marketing comme les autres, sinon je ne vendrais pas. »
La difficulté du terme urbain réside en fait dans la multitude de définitions qu’on peut lui donner. Affiché haut et fort sur les devantures des commerces, aucun ne lui trouvera la même définition. Selon la linguiste Brigitte Rasoloniaina, cela s’explique avant tout par sa provenance d’un terme avant tout anglophone « urban ». « Il est devenu courant car avec l’évolution actuelle des espaces, on s’interroge beaucoup sur le milieu urbanisé qui est visiblement l’avenir, avec les constructions, les mobilités et les espaces de rencontre des individus qui quittent les espaces peu « urbanisés » », souligne la maître de conférences à l’Inalco. Elle ajoute : « Le terme "ville" pose quelques nuances – on l’oppose à la campagne – et limites qui ne couvrent pas le sens de "urban", que j’explique toujours comme un espace en voie d’urbanisation. »