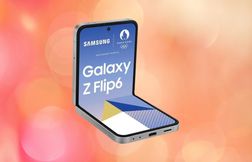Les jeunes sont-ils vraiment « pas woke », comme l'affirme une récente étude de l'Institut Montaigne ?
JEUNESSE•« Nous ne nions pas qu’il existe des jeunes "woke", mais nous disons que la jeunesse, dans son ensemble, n’est pas "woke", expliquent dans « Le Monde » les auteurs de « La jeunesse plurielle »Camille Poher
L'essentiel
- Ce jeudi, l’Institut Montaigne a publié, La jeunesse plurielle, une étude réalisée par les deux sociologues Olivier Galland et Marc Lazar. Elle s’attarde sur les difficultés ressenties au quotidien par la jeunesse française.
- Selon cette enquête, il n’existerait pas vraiment de fracture entre les générations mais davantage des évolutions de valeurs. En somme, les jeunes ne seraient pas si « woke » que cela.
- Nous avons interrogé Frédéric Dabi, directeur général opinion de l’Ifop, sur cette notion de wokisme et la place que cette forme de culture occupe dans la vie des jeunes.
Dans une étude #MoiJeune Opinionway-20 Minutes* sur le rapport des 18-30 ans à l’élection présidentielle – à paraître mercredi prochain et dont nous vous dévoilons les premiers résultats en exclusivité –, les jeunes se voient, à 29 %, dans une France plus « égalitaire d’ici cinq ans ». « Dans une France qui agit davantage contre les discriminations, le racisme, les inégalités sociales et économiques », soit les fers de lance d’une culture qui fait beaucoup parler d’elle : la culture « woke ». Et, ce jeudi, l'Institut Montaigne – le think tank français qui défend des orientations libérales – a publié son enquête La jeunesse plurielle. Dans cette étude menée par Olivier Galland, directeur de recherche au CNRS et Marc Lazar, professeur d’histoire et de sociologie politique à Sciences-Po Paris, les jeunes présenteraient des profils trop différents pour permettre de parler d’une mouvance « woke » en France. Alors « woke » ou pas « woke » les jeune, telle est la question.
C’est quoi être « woke » ?
Pour rappel, le mot « woke » est né dans les communautés afro-américaines dans les années 1950, et regroupait des personnes dites « éveillée aux enjeux politiques ». En 2021, être « woke » signifie, plus largement, être conscient des injustices sociales et politiques mais aussi lutter contre le racisme et l’oppression vécue par certaines minorités.
Et selon Frédéric Dabi, directeur général opinion de l’Ifop et auteur de La Fracture, la notion de « wokisme » ou de « culture woke » repose sur deux piliers fondamentaux : « D’abord, être "woke", c’est rejeter en bloc toutes les injustices et les discriminations vues comme systémiques. » En d’autres termes, faire front face à toutes les inégalités consécutives aux décisions des pouvoirs publics. « L’autre fondement du « wokisme » c’est la sacralisation des minorités , ajoute l’analyste politique qui dresse un portrait détaillé des 18-30 ans, sur la base d’une succession de grands sondages d’opinion diligentés par l'Ifop lui-même de 1957 à 2021. Lorsqu’on est "woke", on valorise et on défend, coûte que coûte, ceux qui sont sous-représentés dans la société ».
A quoi ressemble le jeune « woke » ?
Surprenant, ou non, l’adhésion à la notion de wokisme est plus marquée chez les jeunes femmes. « Le jeune woke est plutôt une femme, âgée d’entre 18 et 20 ans et encartée à gauche, résume Frédéric Dabi d’après les chiffres issus d’une enquête de l’Institut français d'opinion publique (Ifop). Le niveau de diplôme conditionne également l’adhésion à une culture « woke », souvent mieux maîtrisée par les plus diplômés. » Le milieu social n’est pas pour autant déterminant dans le profil du « jeune woke », selon Frédéric Dabi : « Prenez la question du racisme d’Etat, sujet prépondérant de l’éveil des consciences collectives. Sur cette question 41 % d’enfants d’ouvriers et 34 % d’enfants de CSP + se disent concernés. La différence entre les deux reste donc tout à fait relative. »
Reste que le constat qui ressort de l’enquête La jeunesse plurielle est finalement que les jeunes ne sont pas « une génération woke ». Il n’existe pas de fracture entre les générations mais davantage des évolutions de valeurs et d’approches.
Alors pourquoi certains jeunes sont-ils « woke » et d’autres pas ?
« A mon sens, ce n’est ni la dimension sociale, ni la dimension politique ou religieuse qui prévaut dans l’adhésion ou non à une culture "woke" », répond Frédéric Dabi. Selon l’expert, le wokisme est un phénomène générationnel. Une culture embrassée par les plus jeunes des jeunes. « Les lycéens sont "woke" presque par essence. Peu importe leur milieu social, leur bord politique ou leur religion, ils sont particulièrement à fleur de peau sur les sujets sociétaux qui font la culture "woke" ». Si au sein des 18-30 ans les jeunes ne sont pas égaux face à leur adhésion au « wokisme », les chiffres démontrent cependant qu’un sujet continue de rassembler, peu importe l’âge : le climat.
Toujours selon l’étude Ifop, l’environnement est ainsi une préoccupation centrale pour cette tranche d’âge avec 91 % des jeunes se déclarant prêts à réaliser au moins une action pour lutter, à leur niveau, contre le réchauffement climatique. Preuve en est également, ces 23 % des 18-30 ans qui assurent dans l’étude conjointe #MoiJeune Opinionway-20 Minutes* espérer vivre dans cinq ans dans une « France plus écologique, qui agit davantage pour l’environnement et la lutte contre le changement climatique ».
Et du côté de l’étude La jeunesse plurielle, il est expliqué que ce n’est pas tant les jeunes qui sont ou ne sont pas « woke » qui est important, mais plutôt le « niveau de wokisme » attribué à chaque enjeu de société. Concernant la laïcité par exemple, « une bonne partie des jeunes partage l’idée que le respect des convictions et des choix personnels est un principe supérieur au respect des règles qui ordonnent la vie publique » mais ces questions ne sont pas un sujet de préoccupation majeur pour eux. Idem pour la question du genre et de l’évolution des droits des personnes LGBT+ qui sont « citées plus souvent par les jeunes comme des sujets très importants » mais ne sont jugés très importants respectivement par 28 % et 35 % des 8.000 jeunes de 18 à 24 ans interrogés, loin derrière les violences faites aux femmes (77 %), par exemple.
Notre dossier MoiJeune
Le mot de la fin reviendra donc à Frédéric Dabi : « Il existe bien des jeunes "woke" mais dire de la jeunesse, dans son ensemble, qu’elle est "woke" serait une généralité ». Et faire des généralités, ce n’est définitivement pas « woke ».