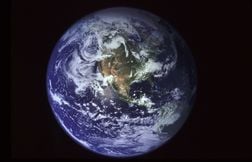« Beaucoup de femmes qui portent le niqab sont aussi dans une démarche très adolescente, de réaction contre l’ordre établi », considère la sociologue Agnès De Feo
INTERVIEW•Pendant plus de dix ans, la sociologue Agnès De Feo a rencontré et interrogé des femmes françaises portant le voile intégralPropos recueillis par H.S
L'essentiel
- Cela fait dix ans que le texte interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public a été adopté en France.
- Entre 2008 et 2018, la sociologue Agnès De Feo a rencontré et recueilli la parole de centaines de femmes portant le niqab.
- Après une thèse, la chercheuse a publié une synthèse de son travail dans un livre, intitulé Derrière le niqab.
Edit : Nous republions cette interview de Agnès De Feo parue il y a quelques semaines, dix ans après l’adoption de la loi sur l’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public, le 11 octobre 2020.
Il y a dix ans, la France se déchirait sur la question de l’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public. « Négation de soi », « atteinte à la dignité humaine », « accoutrement obscène »… Aujourd’hui encore, la sociologue Agnès De Feo se souvient des termes alors employés par une partie de la classe politique favorable à la loi d’interdiction – adoptée en octobre 2011 sous l’impulsion du président de la République Nicolas Sarkozy – et relayés massivement dans les médias. À l’époque, la chercheuse travaille depuis deux ans déjà sur les femmes qui portent le niqab. « Je voulais les entendre », explique-t-elle aujourd’hui à 20 Minutes. Entre 2008 et 2018, Agnès De Feo rencontre plus d’une centaine d’entre elles.
Après plusieurs documentaires et une thèse consacrée à ce sujet, elle a publié une synthèse de ses travaux dans un ouvrage intitulé Derrière le niqab* (éditions Armand Colin). La sociologue dresse le portrait de 16 femmes aux profils divers. Certaines, radicalisées, sont parties en Syrie rejoindre les rangs de Daesh, d’autres ont abandonné le voile intégral et parfois la religion. À deux jours de la présentation par Emmanuel Macron de sa stratégie de lutte contre les « séparatismes », dont le séparatisme islamiste, Agnès De Feo pointe notamment les effets incitatifs de lois d’interdiction.

Il y a dix ans, la France a officiellement interdit le port du niqab. Selon vous, qui avez passé dix ans à suivre et écouter des femmes qui ont porté le voile intégral, quelles conséquences cette loi a-t-elle eues ?
J’ai commencé mon étude en 2008 – soit un an avant le début de la polémique sur le niqab, qui démarre en juin 2009 avec la mise en place d’une commission d’enquête dédiée à l'Assemblée nationale. Ce que j’ai pu observer, c’est que la polémique a eu un effet incitatif sur le port du niqab, qui s’est renforcé avec le vote de la loi en octobre 2010. J’ai rencontré deux groupes de femmes bien distincts, celles qui portaient le niqab avant la loi et celles qui ont décidé de le porter après la loi. Celles qui le portaient avant sont des femmes piétistes, très croyantes, dans une démarche ascétique, qui cherchent presque à se couper de la société mais comme des religieuses, et dans une démarche qui ne concerne qu’elles.
Le second groupe a été attiré par ce marqueur visible de l’islamité parce qu’il posait problème à la société. Elles ont envie de se démarquer et revendiquaient le port du niqab comme une revanche sur la société. Certaines ne portaient même pas le voile avant la loi et j’ai rencontré des femmes qui se sont converties à l’islam au moment de la polémique, parce que cela devenait subversif. La plupart de ces converties viennent par ailleurs de familles athées ou agnostiques et parfois islamophobes. Cet effet incitatif de la loi est très important et a été complètement négligé par la classe politique, qui n’a pas compris que le texte pouvait avoir cet effet-là.
Dans votre enquête vous vous attachez à déconstruire les idées reçues sur ces femmes qui portent le voile intégral. Lesquelles sont, selon vous, les plus éloignées de la réalité que vous avez étudiée ?
Le premier enseignement, c’est que, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, celles qui portent le voile intégral ne sont pas – ou très rarement – des femmes soumises mais plutôt des femmes insoumises. Elles sont très autoritaires, très exigeantes, à la recherche du « musulman parfait ». À tel point qu’elles cumulent souvent des liaisons très courtes avec des hommes qui finissent mal.
L’autre fait notable, c’est leur légèreté en matière de religion et leur manque de connaissances religieuses, surtout pour celles qui ont choisi de porter le niqab après 2010. Leurs références sont surtout tirées d’ouvrages trouvés sur Internet et rédigés par des auteurs saoudiens qu’elles appellent des « savants ». Mais ce sont des ouvrages qui listent essentiellement des « règles » de comportement ou d’habillement pour être une « bonne musulmane », donc cela reste très superficiel et focalisé sur l’apparence.
Vous écrivez que le port du niqab doit s’appréhender comme une « manifestation de modernité » et non comme un retour aux traditions. Pourquoi ?
Quasiment toutes les femmes qui portent le niqab et que j’ai interrogées sont nées en France. C’est important de le rappeler. Elles ont été scolarisées dans des écoles publiques, parfois dans des établissements catholiques, mais pas du tout dans des écoles confessionnelles musulmanes. Elles traduisent, dans le port du niqab, une forme de malaise par rapport à la place de la femme dans la société française.
Beaucoup m’ont dit qu’elles en avaient marre d’être objectivées par les hommes, qu’elles voulaient rester « maîtresses » de leur corps, et certaines se disent même féministes ! Je sais que cela peut être difficile à entendre, mais c’est ce qu’elles pensent et clament. Il faut rappeler aussi que ce vêtement n’était pas du tout porté par leurs aïeuls puisque le niqab est un costume importé d’Arabie saoudite qui correspond à une vague de « réislamisation ». Beaucoup sont aussi dans une démarche très adolescente, de réaction contre l’ordre établi, c’est subversif et elles le disent très clairement : « Je suis plus forte que l’Etat » ou « on ne me contraindra à rien ».
On constate pour autant qu’une partie de celles que vous avez suivies – dont la djihadiste devenue membre de Daesh Emilie König – font du niqab un argument politique au service d’une idéologie radicale…
C’est ce qu’on appelle un retournement du stigmate. C’est-à-dire qu’on revendique sa propre stigmatisation. Je n’imaginais pas pour autant que certaines des femmes que j’ai rencontrées iraient jusqu’à partir en Syrie pour rejoindre Daesh. Les agressions physiques – dont beaucoup ont été victimes une fois la loi votée – ont créé chez certaines un sentiment de révolte et une colère forte. Emilie König, par exemple, ne portait pas le niqab avant le vote de la loi et elle a politisé le port de son voile intégral au fur et à mesure. Ensuite, effectivement, elle était dans une recherche constante d’interdit et de radicalité.
Ce vendredi, Emmanuel Macron va présenter sa « stratégie » pour lutter contre les séparatismes, et notamment le « séparatisme islamiste ». Quel regard portez-vous sur cette question, qui revient régulièrement dans le débat public ?
Le séparatisme, ce sont les gouvernements successifs qui l’ont créé. Les écoles confessionnelles musulmanes étaient rarissimes avant le vote de la loi de 2004 sur l’interdiction des signes religieux à l’école. Idem pour la loi sur l’interdiction du voile intégral, c’était une pratique très marginale. Et on risque de se retrouver aujourd’hui avec le même phénomène avec l’interdiction du certificat de virginité, alors que cette pratique est déjà prohibée par les médecins et gynécologues. On donne une caisse de résonance à tout cela. Ce qui me frappe, c’est que dès que cela touche à l’islam et à l’islam radical, on ne parle que dans l’abstraction. On manque de chiffres, de terrain, d’enquêtes et on crée des phénomènes qui n’existent pas ou qui sont ultraminoritaires dans un intérêt électoraliste. Le débat public va encore s’enflammer et le risque de stigmatisation est réel.