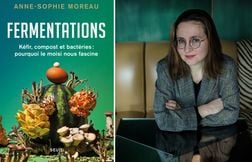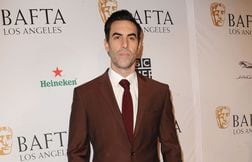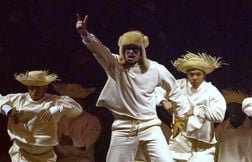Biologie numérique : L’informatique va-t-elle réussir à éradiquer les maladies ?
PROGRAMMATION•Si la science a réussi à comprendre la biologie du Covid-19 en si peu de temps, c’est notamment grâce à la biologie computationnelleLaure Beaudonnet
L'essentiel
- La biologie computationnelle a mis un coup d’accélérateur aux progrès de la biologie.
- En moins d’un an, on a réussi à comprendre une grande partie de la biologie du virus du Covid-19.
- La reprogrammation cellulaire et la biologie de synthèse – deux champs de la biologie computationnelle – pourraient permettre à la science de soigner des maladies comme Alzheimer, l’ostéoporose ou même de créer du sang.
Imaginez que l’informatique puisse créer du sang, transformer des cellules de graisses en os pour soigner l’ostéoporose ou carrément créer une cellule à partir de zéro pour lui assigner une mission dans notre corps. Cette idée paraît folle, mais elle pourrait devenir réalité. La biologie computationnelle (ou numérique) a fait un bond technologique ces dernières années, grâce aux progrès de l’intelligence artificielle notamment, permettant d’envisager des choses considérées comme de la science-fiction il n’y a pas si longtemps.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, revenons sur cette discipline qui mélange la programmation informatique et la connaissance du vivant. A chaque fois qu’un chercheur en biologie a besoin d’outils pour l’aider, la biologie computationnelle lui apporte des modèles ou des logiciels qui vont permettre d’accélérer sa recherche. Ces dernières années, la compréhension du vivant a pris un tournant.
L’IA rend possible des choses inespérées
Avant l’apparition du séquençage haut débit en 2010, il fallait des années et engager des millions d’euros pour séquencer le génome d’une nouvelle espèce. Depuis une dizaine d’années, il est possible de le faire en très peu de temps et pour une somme modeste. « Cela vaut pour le coronavirus SARS-CoV-2, explique Hélène Touzet, directrice de recherche au CNRS. En moins d’un an, on a réussi à établir le génome du virus et à partir de là comprendre une grande partie de sa biologie. » Et l’intelligence artificielle – plus précisément le machine-learning – n’est pas étrangère à tout ça.
La biologie, aujourd’hui, est capable de produire beaucoup plus de données observationnelles, notamment grâce au séquençage haut débit. Et on le sait : plus il y a de données pour nourrir l’IA, plus elle est performante. « C’est comme avec la reconnaissance faciale, une fois que vous avez montré beaucoup de visages à la machine, elle pourra distinguer un homme d’une femme, un jeune d’un vieux, etc. », pointe Martin Weigt, chercheur au département de biologie computationnelle et quantitative à l’université Pierre-et-Marie-Curie. En biologie, c’est le même principe. A partir de l’observation, elle pourra prédire les règles et déduire des comportements.
Imaginons : « Je dois faire un milliard de tests et chaque test prend deux semaines, c’est impossible, pointe Martin Weigt. Maintenant, je fais mon analyse de biologie computationnelle et [grâce à la modélisation] je dis qu’il y en a une centaine qui pourrait avoir une bonne probabilité de succès. A la place d’un milliard de tests, je fais 100 tests, et sur les 100, il y en a 10 qui marchent ». Si on comprend comment les processus fonctionnent, on peut envisager de les reprogrammer.
Changer la mission d’une cellule
Pour l’heure, la biologie computationnelle avance encore un peu dans le brouillard. « Si vous imaginez qu’une cellule est un grand sac rempli de molécules, alors on sait tout. Mais la cellule n’est pas un sac de molécules, explique Martin Weigt. Les molécules interagissent entre elles, l’une est un régulateur de l’autre, et l’autre en influence trois autres… On ne peut comprendre la cellule que si on a une vision du comportement collectif de tous les composants ». On en sait déjà beaucoup mais le chemin reste long.
On sait, par exemple, qu’il est possible de changer la fonction d’une cellule. En 2012, Shinya Yamanaka a reçu le prix Nobel pour avoir réussi à transformer une cellule adulte différenciée, de peau par exemple, en une cellule indifférenciée, ou cellule-souche embryonnaire. « On cherche un ensemble de gènes à perturber qui vont permettre de déstabiliser la cellule pour qu’elle change de mission, décrit Loïc Paulevé, chercheur au CNRS en biologie computationnelle. Selon les conversions qu’on veut faire, on cherche encore les bons cocktails de gènes ».
Et la biologie computationnelle donne des gros coups de main de ce côté-là. « On développe des programmes qui essaient de se comporter comme des cellules, poursuit le chercheur. Au lieu de faire des expériences en vrai, qui demandent du temps et de l’argent, on fait l’expérience sur l’ordinateur pour suggérer des cocktails à essayer ensuite en laboratoire ». La machine agit un peu comme guide pour les chercheurs. Elle cherche virtuellement des modèles et lorsqu’il y en a un qui fonctionne, il ne reste plus qu’à l’essayer en vrai. Car à la fin, c’est l’expérience qui donnera la réponse.
Dans le futur, ces technologies pourraient permettre de soigner l’ostéoporose ou Alzheimer, par exemple, « en stimulant de nouvelles cellules cérébrales », comme l’explique Microsoft, très actif sur le sujet par l’intermédiaire de son laboratoire Station B. On pourrait imaginer générer de nouvelles cellules que le corps vieillissant ne parvient plus à produire ou, en agriculture, faire en sorte que les arbres produisent plus de fruits.
Un futur sans maladie
Un futur sans maladie et sans famine est-il envisageable ? La médecine et l’agroalimentaire sont en tout cas deux domaines d’application privilégiés de la biologie computationnelle. « Les OGM sont un peu les prémices de la reprogrammation, observe Loïc Paulevé. Quand on fait de la reprogrammation cellulaire, on encourage les cellules à prendre les fonctions qui nous intéressent. On peut avoir un contrôle plus fin, sans forcément modifier génétiquement. »
Retrouvez la rubrique Futur(s) ici
Le vrai pas dans le futur, c’est celui de la biologie synthétique. Cette branche de la biologie computationnelle cherche à créer un système biologique de A à Z. « On va programmer une cellule depuis zéro », précise le chercheur. « Au lieu de partir de cellules existantes, on va partir d’une cellule qu’on a construite à partir d’un premier programme. On va regarder comment elle se comporte et on va affiner, détaille Loïc Paulevé. Il reste encore beaucoup de progrès à faire du point de vue informatique et de l’intelligence artificielle pour construire des modèles fiables. »
A terme, on pourrait imaginer introduire une cellule dans le corps pour rechercher des pathologies et poser un diagnostic. Elle pourrait avoir comme mission d’aller en tuer une autre, dans le cas du cancer, par exemple. Les maladies ne seront alors plus qu’un lointain souvenir (bon, peut-être pas demain non plus).